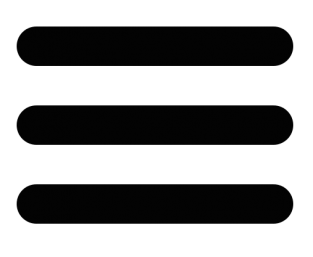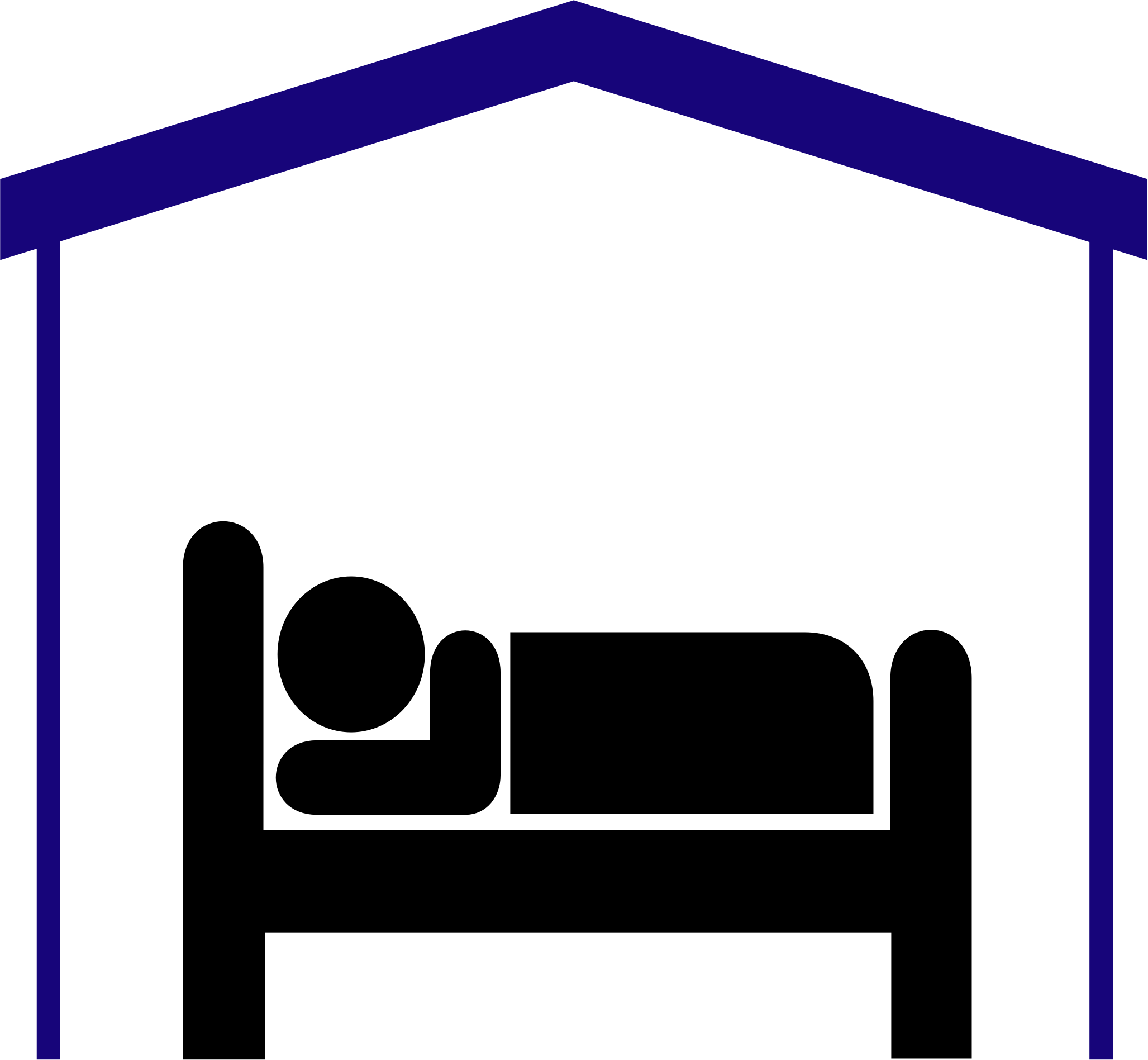Introduction
Marx pensait que l’histoire suivait des phases, et que le capitalisme n’en était qu’une étape. On découvre aujourd’hui que le capitalisme a lui-même une histoire, qu’il ne s’incarne pas lui-même au XX° siècle comme au XIX°, qu’il n’est pas semblable aujourd’hui à ce qu’il était hier.
Le capitalisme du XX° siècle s’est construit autour d’une figure centrale : celle de la grande firme industrielle. Celle-ci instaure entre ses membres ce que Durkheim aurait pu appeler une solidarité mécanique. Les ingénieurs réfléchissent à la manière de rendre productifs les ouvriers sans qualification. Les dirigeants sont eux-mêmes salariés, et leurs objectifs rejoignent ceux de leurs subordonnés : protéger la firme contre les aléas de la conjoncture.
Le capitalisme du XXI° siècle organise scientifiquement la destruction de cette société industrielle. Les différents étages de la grande entreprise industrielle sont dissociés les uns des autres. On recourt aux sous-traitants pour les tâches réputées inessentielles. On regroupe les ingénieurs dans des bureaux d’études indépendants, où ils ne rencontrent plus guère les ouvriers. Les employés chargés du nettoyage, des cantines, du gardiennage sont, chacun, recrutés par des entreprises spécialisées.
La révolution financière des années 1980 change les principes d’organisation des firmes. Un actionnaire n’a nullement besoin qu’une même entreprise fabrique « des maillots de bain et des parapluies » (logique conglomérale, de diversification des produits). Il lui suffit, pour diversifier son risque, de détenir une action de l’une et de l’autre. Dans un renversement copernicien des fondements mêmes du salariat, ce sont désormais les salariés qui subissent les risques, et les actionnaires qui s’en protègent. C’est la fin de la solidarité qui était inscrite au cœur de la firme industrielle.
La société de services
Pour caractériser notre nouvelle organisation sociale, on peut parler de société de services (Jean Fourastié, Le grand espoir du XX° siècle, PUF, 1949). Avec l’avènement d’une société de services, la matière travaillée par l’homme est l’homme lui-même. Coiffeur ou docteur, le travailleur renoue un contact direct avec les humains. Les économistes anglo-saxons ont forgé un terme fidèle à l’idée de Fourastié : le « Face to Face » ou (« F2F »).
En octobre 2005, le journal anglais The Economist publiait un article indiquant que la part des emplois industriels aux Etats-Unis était descendue en deçà des 10 %.
Pourtant, il faut lever un malentendu : l’économie tertiarisée n’est nullement « débarrassée » du monde des objets. Ils coûtent moins chers, la part de la production se réduit en valeur, mais en volume, ils continuent à croître aux mêmes rythmes qu’avant. Le grand espoir d’un travail libéré de la dureté lié au monde physique des objets n’est certainement pas advenu, comme en témoigne la hausse régulière des salariés qui souffrent de douleurs physiques et se plaignent de déplacer des objets lourds (Philippe Askenazy, Les désordres du travail, Seuil, 2004).
Au sein du monde tertiarisé, les ouvriers sont devenus minoritaires (manutentionnaires, réparateurs, ouvriers de l’artisanat). Les employés travaillent maintenant majoritairement dans le commerce ou les services aux particuliers.
La société de l’information
Cette façon d’analyser la sortie de la société industrielle n’épuise pourtant pas la question : on peut également la définir comme une société de la connaissance (Daniel Bell, The Coming of the Post-Industrial Society, New-York, Harper, 1973) ou une société de l’information.
La « nouvelle économie » est très différente de celle analysée par Marx ou Adam Smith, reposant sur la mise en œuvre du travail productif, base de la valeur des objets produits.
La nouvelle économie se caractérise par une structure de coût totalement atypique : un logiciel coûte cher à concevoir, mais pas à fabriquer. Dans la « nouvelle économie », c’est la première unité du bien fabriqué qui est onéreuse ! Les autres ont un coût négligeable, voire nul. Dans le langage de Marx, il faudrait dire que la source de la plus-value n’est plus dans le travail consacré à produire le bien, mais dans celui passé à le concevoir.
Voir par exemple les médicaments : le plus difficile est de découvrir la molécule. Le coût de fabrication du médicament lui-même, que l’on mesure par le prix des médicaments génériques, est beaucoup plus faible que l’amortissement des dépenses de recherche et de développement qui est facturé dans les médicaments sous licence… Voir aussi film, code numérique, …
Ce paradigme intéresse aussi les firmes industrielles : la firme Renault tend à fabriquer
une part de plus en plus faible des voitures qui portent sa marque. Dans les années 50 : 80 %, aujourd’hui : 20 %.
À l’heure de la mondialisation, les firmes cherchent à se recentrer sur les activités à rayon planétaire, celles qui touchent le plus grand nombre de clients. Les activités immatérielles, où le coût est dans la première unité, la promotion de la marque sont beaucoup plus intéressantes que la stricte fabrication des biens qui en découlent.
La « société » postindustrielle
Durkheim expliquait que la solidarité mécanique entre les membres d’une société post-industrielle faisait place à une solidarité organique entre les membres d’une société régie par la division du travail social. Celle-ci fait naître, selon, lui, un système de « droits et de devoirs qui lient les hommes entre d’une manière durable ». Dans le monde où nous entrons, on chercherait en vain la solidarité organique que Durkheim appelait de ses vœux.
Leçon I
L’ère des ruptures
5 ruptures majeures pour cette nouvelle « grande transformation » (Karl Polanyi, La grande transformation, Gallimard, 1944, 1983).
La troisième révolution industrielle
Une nouvelle conception du travail humain
Une révolution culturelle (mai 68)
La finance qui a imposé sa logique à l’industrie
La mondialisation
Une révolution technologique
Fin XVIII° : la machine à vapeur
Fin du XIX° : électricité, téléphone, moteur à explosion
Années 70 : mise au point d’Arpanet par le département de la défense américain (1969) ; 1971 : Intel met au point le premier processeur ; 1976 : commercialisation d’Apple II (ordinateurs de bureau).
Pour caractériser les révolutions industrielles, les économistes parlent de General Purpose Technology (GPT) : des technologies à usage multiple dont le potentiel excède les intentions et l’imagination de leurs inventeurs. Internet excède l’intention des analystes du Pentagone qui cherchaient une réponse technique à une hypothèse improbable : une frappe nucléaire soviétique qui aurait détruit les capacités de transmission militaire.
Une révolution sociale
Seconde rupture : l’organisation du travail. De même que l’électricité va de pair avec ce qui deviendra l’OST de Taylor, de même aujourd’hui la révolution informatique va de pair avec une nouvelle organisation du travail qui semble indissociable de son avènement.
Les nouveaux principes de l’organisation du travail
Selon Philippe Azkenazy, les objectifs que s’assigne l’organisation du travail à l’âge d’Internet sont : « l’adaptabilité à la demande, la réactivité, la qualité et surtout l’optimisation du processus productif, notamment à travers l’utilisation de toutes les compétences humaines. Ces objectifs se traduisent par une polyvalence accrue des salariés et une délégation de responsabilité aux niveaux hiérarchiques inférieurs. »
Exemples : la dactylo, le vendeur, l’employé de guichet dans une banque. La dactylo voit son travail supprimé par le traitement de texte. Le cadre rédige lui-même ses rapports. Le vendeur devient polyvalent et exécute plusieurs tâches à la fois (il gère les stocks, conseille le client, l’accompagne à la caisse). Voir le système mis en place dans les usines Toyota dès les années 60 : organisation du travail plus flexible, qui permet aux ouvriers de faire remonter les informations concernant leurs besoins en pièces détachées, en couleur… Méthode qui marque le début de la fin du taylorisme. L’un des effets de ces réorganisations est de réduire la part d’emploi affectée au personnel d’encadrement. Les échelons intermédiaires sont aspirés vers le haut et plus souvent encore vers le bas. La condition ouvrière est transformée (S. Beaud, M. Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, Fayard, 1999) : elle est de plus en plus fermée sur elle-même, privée de l’accès aux échelons intermédiaires. On est de plus en plus souvent smicard à vie.
Quel est le principe économique qui permet de comprendre cette polyvalence ? La nouvelle organisation du travail fait tout pour tuer les temps morts. La chasse aux temps morts impose qu’un employé ait toujours une tâche à faire. Elle-même est la conséquence mécanique d’une donnée fondamentale : la hausse de la valeur travail.
Entre le début du XX° siècle et le début du XXI° siècle, le salaire ouvrier a été multiplié par 7 (relativement au prix des marchandises et des investissements). Dès lors, tout principe organisationnel qui en réduit la part conduit à des économies beaucoup plus importantes.
Ce néo-stakhanovisme conduit sans doute à une intensification du travail humain, plus qu’à une hausse de productivité. S’il n’y a plus de temps mort, si les gens travaillent tout le temps, on travaille plus et non pas, minute par minute, de manière plus productive (Michel Aglietta).
Loin de signifier toutefois l’avènement du « grand espoir du XX° » , ce monde post-industriel multiplie les désordres physiques et mentaux. Voir le livre de Philippe Askenazy, Les désordres du travail. Selon l’OCDE, les maladies mentales qui sont recensées parmi les bénéficiaires d’allocation d’incapacité sont passées de 17 % à 28 % en moins de dix ans.
Les causes physiques des accidents du travail restent importantes : les troubles musculo-squelettiques sont devenus la cause principale des maladies professionnelles recensées. En moyenne, les pratiques innovantes en matière d’organisation du travail (contrôle de qualité, rotation des postes, flexibilité du temps de travail) créent ainsi un surcroît d’accidents du travail variant de 15 % à 30 %, majoritairement liés à des fatigues physiques ou à leur cumul avec des tensions psychiques.
Les contradictions du fordisme
Dès le départ (1913) le fordisme est habité par une contradiction interne. L’organisation scientifique du travail est répétitive, ennuyeuse, aliénante. D’où la nécessité pour Ford de doubler le salaire journalier des ouvriers : « Five dollars a day ».
La théorie du salaire d’efficience (Mark Shapiro et Joseph Stiglitz, « Equilibrium unemployement as a Worker Discipline Device », American Economic Review, 1984) permet de comprendre que l’on peut améliorer la productivité d’un travailleur en augmentant son salaire alors que l’idée habituelle est inverse. Toute l’histoire du fordisme se trouve dans cette inversion des termes : en augmentant les salariés, on accroît leur productivité.
La contradiction du fordisme se joue ici : pour acheter l’assentiment des ouvriers, il ne suffit pas de doubler leur salaire par rapport à ce qu’ils gagnaient auparavant ; il faut aussi le faire par rapport à ce qu’ils gagneraient ailleurs. Or, en se généralisant, le fordisme ne peut que dépérir par la hausse des coûts salariaux unitaires (hausse des salaires supérieure aux gains de productivité) se traduisant par de l’inflation.
Le fordisme se heurte à une autre contradiction : il a été inventé pour une population illettrée. Les progrès de l’éducation ruinent les fondements du fordisme. D’où la révolte de la jeunesse étudiante et ouvrière partout dans le monde développé.
Mai 68
Mai 68 est le moment où les étudiants récusent la société hiérarchique léguée, subie, par leurs parents. Cette protestation est un trait commun à tous les pays industrialisé.
Il en dégage deux caractéristiques : la critique des institutions qui doivent passer d’une légitimité innée à une légitimité acquise.
L’auteur est critique vis-à-vis de la thèse de l’individualisme comme caractéristique du mouvement : il préfère caractériser Mai 68 par l’émergence de la jeunesse comme force sociale autonome. Les jeunes ouvriers participent à leur façon au mouvement en refusant le travail aliénant en usine.
Cette jeunesse a d’ailleurs été à l’origine des évolutions technologiques majeures dès le début des années 70 : Internet, modem.
La révolution financière
La révolution financière des années 80 marque la quatrième rupture. Après la crise de 1929, le pouvoir de la bourse avait été délégitimé. Les actionnaires avaient abandonné la direction des entreprises à des managers (G. Berle et C. Means, Modern Corporation and Private Property, New-York, 1932). Ces managers salariés se contentaient de rémunérations de l’ordre de 40 fois le salaire ouvrier (norme édictée par D. Rockefeller). Le chiffre américain est aujourd’hui de 400.
Les managers sont arrachés au salariat (stock-options). Ces incitations offertes aux managers (plus-values boursières, parachutes dorés) sont censées être le fruit de la croissance de l’efficacité productive des firmes (Michael Jensen). Andrei Shleifer et Larry Summers (deux économistes de Chicago, 1988) ont une tout autre interprétation : la révolution financière des années 80 a créé de la valeur en annulant nombre d’engagements implicites avec les partenaires de la firme (les « stakeholders ») au profit des actionnaires (« les shareholders »). Parmi ces partenaires : les salariés anciens, les sous-traitants… Ces fusions apparaissent pour eux comme « une rupture de confiance ».
Le nouveau capitalisme actionnarial est passé par deux phases : dans les années 80, la mode est au downsizing (les raiders cassent les gros conglomérats) ; dans les années 90, ces firmes peuvent recommencer à grossir sur le seul axe de leur cœur de métier.
Conclusion
La boucle est bouclée. Par tous ses bords, le capitalisme contemporain engage un grand démembrement de la firme industrielle. La pyramide fordiste est débitée en tranches de plus en plus fines.
Cette rupture a plusieurs causes. C’est un moment de la « lutte des classes ». Le nouveau capitalisme casse les collectifs ouvriers et affecte d’abord les firmes les plus syndiquées. Mais les causes externes jouent également un rôle important : contestation du travail à la chaîne, nouvelles technologies, ont favorisé l’émergence d’un « nouvel esprit du capitalisme » (Luc Boltanski et Eve Chiappello, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, Gallimard, 1999). La condition ouvrière se trouve durement affectée par le déclin de l’emploi industriel (S. Beaud et M. Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, Fayard ; Violences urbaines, violence sociale, Fayard).
Leçon 2
La nouvelle économie-monde
La première mondialisation
Le parallélisme entre la mondialisation du XIX° siècle et la nôtre est particulièrement frappant. Ressemblance des grandes puissances (Grande-Bretagne/USA) : même volonté d’imposer le libre-échange au profit de leurs industriels, au-delà des intérêts géostratégiques.
Deuxième analogie : elles sont toutes deux portées par une révolution des techniques de transport et de communication. Par son ampleur, la révolution du XIX° en la matière est sans doute supérieure à celle que nous connaissons : hausse sans précédent de la vitesse des transports des marchandises, des hommes et des informations.
Troisième changement en avance de la mondialisation d’aujourd’hui : les migrations internationales. En 1913, 10 % de la population du monde est composée d’immigrés. Aujourd’hui, ce chiffre n’est que de 3 % de la population mondiale.
Autre paramètre : le respect des contrats ou de la propriété privée. Dans le Commonwealth (ou l’Empire français), l’intégration juridique hier était en avance sur la situation actuelle.
La mondialisation du XIX° n’a rien à envier à celle d’aujourd’hui. Elle offre le laboratoire d’une mondialisation quasiment à l’état pur. Or elle s’est avérée incapable de diffuser la prospérité des plus riches vers les plus pauvres.
En 1820, l’Angleterre est deux fois plus riche par habitant que l’Inde. En 1913, les écarts de revenus sont passés de 1 à 2 à 1 à 10. À l’inverse, un processus de convergence se met en place entre l’Angleterre et les autres grandes nations européennes (France, Allemagne), alors que ces dernières choisissent une voie protectionniste.
Les pays du futur Tiers Monde en tireront la conclusion que le commerce international n’est pas un facteur d’enrichissement des nations pauvres. Mais cette voie protectionniste ne sera pas non plus un succès au XX° siècle… L’écart de richesse entre pays pauvres et riches ne va pas davantage se rétrécir au cours du XX° qu’il ne l’avait fait au XIX° siècle.
Le consensus en faveur du protectionnisme va dès lors s’effriter. Sous des formes diverses, à compter des années 1980 et surtout des années 1990, les pays pauvres vont retrouver la voie du commerce mondial. Une nouvelle division internationale du travail s’esquisse à laquelle les pays émergents participent de plain-pied.
Retour sur la division (internationale) du travail
Il n’est pas inutile de revenir sur ses fondements théoriques que l’on trouve chez David Ricardo au XIX ° siècle. Le marché pousse chacun, l’individu chez Smith, la nation chez Ricardo, à se spécialiser dans une tâche unique, celle où il excelle relativement aux autres.
Il s’agit non pas de choisir la tâche où l’on est le meilleur que les autres dans l’absolu, mais celle où l’on est le meilleur relativement aux autres tâches que l’on pourrait faire soi-même. Pour Smith, on choisit d’être boulanger ou d’être cordonnier en fonction d’un calcul simple : connaissant mes compétences, mon héritage cognitif ou financier, quel est le métier qui me « rapporte » le plus, non pas nécessairement d’un strict point de vue financier, mais du point de vue plus général des plaisirs et des peines qui s’y rattachent.
Toute la modernité d’Adam Smith est d’avoir pensé la possibilité d’une vie en société où la dépendance de chacun par rapport à autrui soit réglée par les forces anonymes du marché (…).
Pour Ricardo, le raisonnement qui est vrai pour un individu l’est aussi pour une nation. Le commerce international permet à chaque nation de se spécialiser dans l’activité ou le secteur où elle dispose relativement aux autres d’un avantage comparatif.
La théorie ricardienne ne prédit pas une hausse des inégalités mondiales. Or les inégalités au cours du XIX° siècle augmentent. Pour l’expliquer, nous pouvons considérer deux régions initialement isolées. L’une est riche, du fait d’investissements initiaux importants (par exemple : infrastructures nombreuses, ouvriers mieux éduqués). L’autre est pauvre parce qu’elle en est privée.
La région riche peut disposer d’une large gamme de produits, de talents, la région pauvre ne peut se spécialiser que dans un nombre limité d’activités. Une polarisation se met en place (opposition centre riche/périphérie pauvre – F. Braudel). Le centre est riche, non parce qu’il est spécialisé, mais parce qu’il est propice à la spécialisation de chacun de ses membres. La périphérie, au contraire, ne pourra se spécialiser que dans quelques tâches (textile, agriculture). D’où pour elle une grande vulnérabilité…
Asymétries donc entre des régions pauvres, ultra-spécialisées et vulnérables à la concurrence des autres périphéries, et des centres polyvalents, mieux protégés des aléas du commerce. Telle est la dynamique du XIX° siècle.
La nouvelle économie-monde
Deux exemples pour comprendre la nouvelle division internationale du travail : la poupée Barbie et les chaussures Nike.
La poupée Barbie : la matière première, le plastique et les cheveux, vient de Taîwan e du Japon. L’assemblage se fait aux Philippines. Les moules proviennent des Etats-Unis tout comme la dernière touche de peinture avant la vente. La spécialisation n’est plus sectorielle, elle porte sur la tâche effectuée par chacun pour produire un produit donné. Cette « désintégration verticale de la production » n’est que le miroir mondial du démembrement de la production fordiste.
La paire de Nike : le modèle Air Pegasus coûte 70 $ aux Etats-Unis. Sa structure de coût est la suivante : le salaire du travailleur est égal à 2, 75 $. Le coût des matières premières et de l’énergie, les coûts de transport et de douanes sont égaux à 16 $ (etc).
Mais il faut ajouter l’ensemble des dépenses engagées par Nike pour faire de ce produit physique un objet social, c’est-à-dire une basket dont les gens auront envie d’acheter : publicité, promotions, embauche d’athlètes. L’ensemble de ces dépenses représentent un coût égal à celui engagé pour produire un objet physique (35 $).
La conception en amont et la prescription en aval deviennent le cœur de l’activité des pays riches. L’étape du milieu, celle de la fabrication, devient inessentielle et peut être externalisée. Dans la nouvelle division internationale du travail, les riches tendent à vendre des biens immatériels et à acheter des biens matériels. La prescription des biens, le face à face, est par hypothèse soustraite aux échanges mondiaux.
Dans le langage technique, les pays riches s’accaparent le segment de la production où les rendements d’échelle sont les plus forts. De même, découvrir un nouveau vaccin représente un coût fixe qui peut profiter ensuite, sans plus guère de dépenses, à la planète entière. Plus la masse des dépenses des bénéficiaires sera importante, plus l’amortissement des dépenses de recherche sera facile, plus il sera rentable d’en engager d’autres.
L’un des enjeux majeurs pour les pays du Sud est de pouvoir participer à la production immatérielle. Rien ne leur garantit une telle évolution : le Mexique par exemple connaît le mauvais versant de la mondialisation, celui d’une périphérie en concurrence avec d’autres périphéries…
La Chine, à l’inverse, crée sur sa façade pacifique des métropoles nouvelles qui visent à la doter de tous les attributs de la puissance. Le modèle chinois est proche de celui du Japon qui a prouvé qu’on pouvait profiter de la mondialisation, à condition de constituer soi-même une « accumulation primitive » des facteurs de croissance. Fort taux d’épargne (50%), scolarisation des enfants remarquable (moins de 20 % d’analphabètes). La division du travail ne fait pas la prospérité, elle n’aide que ceux qui s’aident préalablement eux-mêmes. Pour les pays mal dotés, dont les infrastructures sont rares, la population mal éduquée et soumise à des problèmes de santé publique, les multinationales ne sont pas d’une grande utilité…
La mondialisation des images de la mondialisation
Si la mondialisation ne diffuse pas spontanément la prospérité matérielle à l’ensemble des pays pauvres, elle en diffuse pourtant bel et bien les images. Il existe en effet une différence fondamentale entre la mondialisation présente et celles qui ont précédé : chacun peut devenir spectateur d’un monde auquel, bien souvent, il ne peut participer comme acteur.
Ceci contribue à l’homogénéisation culturelle et à la transformation des comportements, par exemple en matière de fécondité. La transition démographique est à l’œuvre et devrait être achevé en 2050 : la population mondiale devrait cesser de croître à partir de cette date (9 milliards d’habitants). Tous les pays sont affectés, y compris les pays d’Islam. L’Afrique subsaharienne, seule, fait exception : la fécondité féminine reste encore forte (6 enfants par femme). Mais il y a dix ans, le nombre d’enfants était de 7.
Le paradoxe de la transition démographique actuelle tient au fait qu’elle se produit alors même que les conditions matérielles n’ont guère changées. On l’observe dans les campagnes comme dans les villes, que les femmes travaillent ou pas, et parfois avant même que le processus de scolarisation ne soit véritablement engagé (influence des médias).
Les enjeux du monde à venir
Entre aujourd’hui et 2050, la population mondiale va croître de 50%, pour l’essentiel du fait d’une augmentation de la population pauvre. En 2050, la planète comptera 9 milliards d’habitants (et déclinera ensuite). On comptera peut-être 2 milliards de riches, 2 à 3 milliards de gens qui aspireront à le devenir et 4 à 5 milliards de pauvres (moins de deux dollars par jour selon les critères 2007).
Les riches poseront un problème écologique grave. La terre n’est pas compatible avec une extension des modes de consommation actuels à la Chine et à l’Inde. La pauvreté sera source de très fortes tensions.
Le monde de demain sera un monde multipolaire porteur de risques et instable, d’où la nécessité d’un ordre multilatéral, doté d’institutions légitimes, pour désarmer les conflits potentiels.
De ce point de vue, une véritable course de vitesse est engagée.
Leçon 3
Existe-t-il un modèle social européen ?
Le mal européen (1)
L’Europe des 15 représente près de 40% du commerce mondial. Pourquoi craint-elle la mondialisation ? Car les deux tiers de ses exportations et de ses importations sont à destination ou en provenance d’elle-même. Le gros du commerce européen est un commerce de voisinage. C’est un commerce horizontal. Il est représentatif de l’ancien modèle industriel où les firmes vendent clés en main des produits proches (des Renault contre des Mercedes).
Le commerce mondial, lui, est vertical : il découpe la chaîne de production d’un même bien selon des étapes de plus en plus fines.
Les exportateurs européens sont spécialisés dans des produits haut de gamme. Les exportateurs américains le sont dans des produits de haute technologie. La France exporte des produits faibles en technologies du fait de la composition sectorielle des exportations. Bien qu’elle sache produire des biens à haute technologie (Airbus, TGV, centrales nucléaires…), elle est spécialisée dans des secteurs moins consommateurs d’innovations technologiques.
L’Europe reste en partie prisonnière de sa spécialisation passée. Elle s’expose au risque d’être concurrencée par les pays émergents dans le domaine industriel et distancée par les Etats-Unis dans le domaine immatériel.
La nouvelle économie de l’information
La nouvelle économie se caractérise par une structure de coût atypique : c’est la première unité du bien fabriqué qui coûte cher, et non celles qui suivent.
Cette caractérisation de la nouvelle économie permet de saisir la raison pour laquelle elle ne peut s’accommoder d’un régime de concurrence pure et parfaite. Pour amortir ses coûts, une firme de la nouvelle économie doit absolument bénéficier d’une rente de situation. Le secteur ne peut pas être concurrentiel au sens habituel du terme.
Le gratuit et le payant
L’inflation des coûts fixes, propre à la nouvelle économie, n’est pas toujours négative. Dans le cas des entreprises pharmaceutiques, elle accélère les dépenses de Recherche-Développement, propices à l’apparition de nouveaux médicaments. Mais une inefficience majeure apparaît ex post : lorsque le nouveau médicament est découvert, il est tarifé à un cours dissuasif pour les patients les plus pauvres, ceux qui sont en fait les plus nombreux.
Paul David (« A Tragedy of the Public Knowledge Commons », Oxford IP Centre, Working Paper, 2000) avait résumé ces paradoxes de la façon suivante : pour être efficace, la production d’idées nouvelles devrait obéir à deux règles : coopération de tous ceux qui visent à résoudre le même problème, puis une fois le problème résolu, libre usage par tous de ses applications (modèle de la recherche universitaire).
Mais la recherche privée obéit au modèle contraire : les laboratoires sont en concurrence et ne coopèrent pas. C’est donc un modèle à front renversé de celui qui serait efficace. Il y a contradiction entre le développement du savoir commun et l’usage privatif de ce savoir. Cette contradiction rejaillit sous une forme qui devient au XXI ° siècle l’équivalent de ce que fut le conflit entre le secteur public et privé au XX° siècle : la rivalité entre le gratuit et le payant.
La tentation de télécharger gratuitement des films et des chansons, de faire circuler des contrefaçons ou de fabriquer des produits génériques est une donnée permanente de la « nouvelle économie », pour cette raison même qu’il coûte peu de dupliquer la première unité d’un bien, une fois qu’il a été découvert.
Un arbitrage délicat doit être fait entre deux extrêmes : la gratuité radicale, qui menacerait l’innovation privée , et un usage restreint de la propriété intellectuelle, qui fasse la part belle aux monopoles.
C’est à la société de fixer le temps de vie d’un brevet, ses droits d’exploitation, en fonction non pas de principes universels (le respect de la propriété) mais de considérations pratiques (enjeux de santé publique, situation économique du pays, …). Il n’y a par exemple aucune raison de priver les pauvres de médicaments qui pourraient les guérir.
Pour une université européenne
Les universités européennes souffrent de leur taille insuffisante. Elles sont en concurrence avec des universités américaines qui apportent une réponse aux contradictions majeures qui traversent la production de connaissances : l’équilibre entre compétition et coopération, l’arbitrage entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Elles sont concurrentielles, autonomes financièrement, elles organisent la coopération entre les chercheurs. Elles disposent de suffisamment de ressources et de prestige pour discuter d’égal à égal avec le reste de la société, politique et industrielle.
Elles gèrent donc avec efficacité les rapports délicats entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Nous avons besoin d’institutions puissantes et autonomes qui protègent les chercheurs du court-termisme des industriels, sans les conduire pour autant à ignorer la demande sociale qui leur est adressée.
Autre problème posé à l’Europe : la dispersion des dépenses de recherche, qui se présente comme un empilement de recherches nationales. Les Européens sauront-ils créer une Université qui sache faire entrer l’Europe dans l’économie de la connaissance ? Il faut l’espérer, mais ce n’est pas certain. Et l’enjeu est de taille.
Le mal européen (2)
Il n’existe pas de « modèle social » européen.
Le non-modèle social européen
Il fait référence à l’ouvrage de Gosta Esping-Andersen, Les trois mondes de l’État-providence, PUF, 1999. Il souligne l’existence de trois modèles : social-démocrate au Nord de l’Europe, bismarckien en Allemagne, libéral au Royaume-Uni.
Le modèle libéral repose sur le bon fonctionnement des marchés (notamment du travail), le modèle social-démocrate sur des syndicats puissants, capables d’accepter les concessions qui doivent être faites pour atteindre le plein-emploi.
Dans les pays intermédiaires comme la France, où ce sont les syndicats qui sont en concurrence entre eux, le chômage est persistant. Les compromis sociaux ne portent ni sur le plein-emploi, ni sur l’exigence scandinave de solidarité. Le capitalisme continental (France) est néo-corporatiste : il vise à protéger les populations sous statut.
Bruno Amable a ajouté un quatrième type de capitalisme propre à l’Europe : le capitalisme méditerranéen. Il fait reposer la solidarité sociale sur la famille. La France épouse en fait certains traits de ce capitalisme en ne se donnant pas les moyens d’intégrer les jeunes, comme le fait l’Allemagne avec l’apprentissage. Elle reste à cet égard un pays méditerranéen, dans la mesure où elle suppose qu’un jeu de solidarité familiale prendra en charge les jeunes ou les femmes sans emploi.
Mélanges
Il y a toujours un risque à enfermer un pays dans un modèle fixe. Par exemple, les Etats-Unis ont connu des transformations intéressantes. Commentant la baisse spectaculaire des accidents du travail, Philippe Askenazy mettait en exergue trois facteurs : une nouvelle direction syndicale ouverte aux minorités (femmes, minorités ethniques), qui entreprend de syndiquer des milliers d’employés du secteur de l’entretien des bâtiments sur la base de la réforme des conditions de travail. Deuxième facteur : l’usage intensif de la société de l’information (forums Internet permettant de stigmatiser les « mauvaises firmes »). Troisième facteur : le plein-emploi américain à la fin des années 1990 qui contraint les firmes à améliorer les conditions de travail pour attirer les travailleurs.
La crise des banlieues
La crise des banlieues qui a secoué la France au cours de l’automne 2005 offre un formidable résumé de la difficulté française à produire de la cohésion sociale. Le taux de chômage y est pathologiquement élevé (40% pour les jeunes des cités). Les jeunes des banlieues sont privés des solidarités intrafamiliales qui rendent le modèle français supportable aux autres jeunes. Contrairement à l’image d’Épinal d’un communautarisme fort qui serait en soi un facteur d’exclusion, l’existence sociale des jeunes des banlieues est fragile du fait d’un lien communautaire faible.
Le modèle français, qui joue sur la méritocratie républicaine, est allergique à l’idée qu’un lien communautaire fort puisse être un facteur d’intégration. Il préfère souligner plus directement que le niveau scolaire des parents étant faible, le handicap des enfants devient vite insurmontable. Ce raisonnement est pourtant incomplet. Dans les pays émergents, le handicap scolaire des parents est écrasant. Cela n’empêche pas certains d’entre eux de rattraper, parfois en deux ou trois générations, le retard initial. Singapour était, après guerre, un pays à 90 % analphabète, il est aujourd’hui classé parmi les meilleurs, devant la France. Mais contrairement aux enfants de Singapour qui bénéficient de programmes par définition adaptés à leur niveau, l’école de la République fixe une norme qui est celle de la moyenne nationale, inadaptée aux enfants vivant dans les banlieues.
La France, choisissant ses élites dans le creuset de l’école républicaine, veut se convaincre que celle-ci est ouverte à tous. Elle a, ce faisant, beaucoup de mal à penser l’inégalité de fait qui se creuse entre les différents participants à cette course méritocratique. Thomas Piketty et Matthieu Valdenaire ont montré que la taille des classes avait une importance décisive sur les performances des élèves issus des milieux défavorisés, mais sans effet majeur sinon. L’effort pour ces populations pauvres devrait être amplifié.
Conclusion
La nouvelle question sociale
Notre société est menacée par des processus de segmentation sociale : l’usine a cessé d’être un lieu de mixité sociale. Les villes également : riches et pauvres vivent dans des quartiers de plus en plus distincts. Les quartiers populaires tendent à s’éloigner toujours plus des quartiers « chics ». Une série d’univers clos se constituent, qui ne communiquent plus entre eux qu’au travers des visions des quartiers difficiles, où la seule demande sociale est une demande de sécurité publique.
Les appariements sélectifs
Tout se passe comme si les mieux dotés décidaient de rester entre eux. La sécession des plus riches se répercute à l’ensemble de la société. L’endogamie devient la règle. La théorie des appariements sélectifs illustre un point important : les gens se retrouvent entre eux, entre classes sociales homogènes, moins par amour de soi-même que par rejet de l’autre, du plus pauvre. Voir : Eric Maurin, Le ghetto français, Seuil.
Politique, économie, société
L’enchaînement qui fait passer de la société industrielle à la société post-industrielle est caractérisé par le divorce tendanciel entre l’économique et le social (contrairement à la société fordiste où social et économique était alliés).
Le social vit toujours, mais mu par ses propres forces, sans rappel avec celles de l’économie. Il est fréquent d’interpréter cette rupture comme un retour au libéralisme économique, ce qu’elle est indiscutablement. Le fait le plus saillant tient pourtant davantage à ce qu’on pourrait appeler un « libéralisme social » qui est l’équivalent pour les questions sociales aujourd’hui de ce que fut le libéralisme économique au XIX° siècle. Les riches font sécession, se regroupent selon la logique des appariements sélectifs, obligeant ceux du dessous à faire pareil…
Le réel et l’imaginaire
Le social laissé à lui-même étouffe. D’où le communautarisme qui est partout en hausse. Mais, contrairement aux explications communautaristes, il est la réponse à la ségrégation sociale, et non sa cause.
D’une certaine manière, il est possible que la boucle soit bouclée : le religieux est en train de forger une nouvelle alliance avec le social.
L’enjeu, comme au début du précédent millénaire, est à nouveau de fabriquer, de réinventer, des institutions laïques, c’est-à-dire des institutions qui ne soient pas préemptées par les rapports sociaux et culturels. Repenser le syndicalisme, l’Université, penser la gouvernance mondiale d’un côté, celle des villes et des collectivités locales de l’autre, devient aussi important que de pérenniser les fonctions classiques de l’État régalien. Pour chacune de ces institutions, la tâche est la même : construire une infrastructure sociale qui aide les personnes et les pays à vivre un destin digne de leurs attentes, qui les fasse échapper à l’alternative d’un monde réel trop pauvre, et virtuel trop riche.